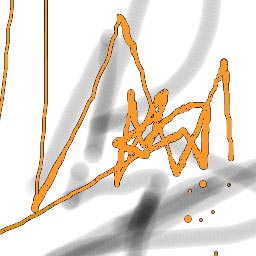L’un des aspects les moins étudiés de l’activité de traduction au Moyen Âge est celui des « traductions latines d’œuvres en langues vernaculaires ». A l’issue d’une journée d’études consacrée au recensement et à la méthodologie qu’exige l’étude de ces traductions, le groupe Tradlat est né. Formé d’un petit groupe de chercheurs – en grande majorité latinistes et romanistes – sensibilisés à cette question, Tradlat envisage de développer un projet de recherche spécifique associant un recensement le moins incomplet possible, progressivement intégré à une base de données consultable sur le web, et un site d’information et de publication. Le souhait des participants est la mise en commun des découvertes faites au hasard de leurs recherches sur les manuscrits.
Du fait des spécialités des « membres fondateurs » du groupe, le domaine des œuvres d’origine française tend à être abordé le premier. Toutefois, il peut apparaître comme le moins bon pour servir de point de départ à une telle enquête, car, dans les derniers siècles du Moyen Âge, le français a fait fonction, après le latin, de langue véhiculaire : compris à un niveau « international », sur le sol anglais après 1066, dans la péninsule Ibérique et dans les États italiens, les textes composés en français pouvaient souvent être accessibles directement sans recours obligatoire à une traduction latine ou vernaculaire, ce qui n’était pas le cas pour d’autres langues vernaculaires moins diffusées.
Difficulté supplémentaire : d’une part, à peu près toutes les langues vernaculaires de l’Europe médiévale ont produit des œuvres originales susceptibles d’avoir été traduites en latin ; d’autre part, les traductions d’une langue vernaculaire dans une autre entrent en concurrence avec les traductions latines de la même œuvre vernaculaire de départ. L’enquête doit ainsi porter sur tout l’espace européen : l’ampleur du sujet dépasse évidemment les forces de quelques chercheurs.
Les traductions latines de la science antique
La culture médiévale latine entretient avec les langues des trois autres grands groupes religieux et culturels avec lesquels elle est en contact (grec, hébreu, arabe) des rapports empreints de contradictions. Connus superficiellement, de manière fragmentaire et souvent inexacte, le grec et l’hébreu doivent leur haute valeur au fait qu’ils sont les langues d’origine des textes sacrés. Quant à l’arabe, il « n’était pas une langue absolument “étrangère” pour la culture latine : une partie du patrimoine philosophique et scientifique est arrivée en Europe pendant les XIIe et XIIIe siècles par le biais de traductions en latin de textes arabes ou d’anciens textes grecs, à leur tour traduits en arabe, éventuellement par la médiation du syriaque [1] ». En outre, les traductions hébraïques [2] jouent entre le monde arabe et le monde latin un rôle médiateur qui, bien que secondaire, peut également être souligné : les traductions latines d’ouvrages écrits par des juifs – ou traduits par eux de l’arabe – visant à compléter le savoir nouveau, récemment découvert, qui était de source essentiellement arabe [3].
Avec la prise de conscience de la nécessité d’apprendre les langues des peuples à évangéliser, pour privilégier la conviction et la controverse sur la conversion forcée, une approche philologique plus attentive se fait jour au XIIIe siècle. Déjà au XIIe siècle, Pierre le Vénérable, inspectant les monastères bénédictins d’Espagne, avait confié, séparément, à l’Anglais Robert de Ketene et au Dalmate Hermann de Carinthie le soin de traduire le Coran [4] et la vie de Mahomet [5] en latin : De generatione Machumet et nutritura. Une deuxième traduction latine du Coran devait suivre, établie en 1209-1210, par Marc de Tolède. Dès lors, les traductions latines du grec, de l’arabe, de l’hébreu allèrent se développant [6], confirmant le latin dans son rôle de langue de culture et de transmission écrite.
Dès le XVIe siècle, les traductions et les traducteurs latins de l’arabe, de l’hébreu et du grec ont attiré l’attention des éditeurs et des érudits. Ces traductions, dont beaucoup transmettent au monde occidental la science antique par le truchement de l’arabe ou de l’hébreu, n’entrent pas dans notre champ de recherche. Certes, nombre d’entre elles font intervenir un intermédiaire arabisant ou hébraïsant pour une traduction en vernaculaire [7], traduction immédiatement interprétée et transcrite en latin. Ce rôle d’intermédiaire des langues vernaculaires – le plus souvent catalan ou castillan, mais aussi provençal, français ou italien – entre les œuvres originales en arabe – c’est le cas du traité de diététique d’Albucasis, des œuvres astrologiques d’Abraham Ibn Ezra [8] – ou en hébreu – c’est le cas d’une partie du livre V des Guerres du Seigneur de Gersonide [9], traduite en provençal par l’auteur lui-même à l’intention de son collaborateur latiniste Pierre d’Alexandrie – et le latin est bien attesté, mais souvent cet intermédiaire vernaculaire n’a été qu’oral : par exemple, pour le Liber de judiciis astrologie d’Ali ben Ragel, traduit de l’arabe en latin en 1256 par Gilles de Thebaldes [10], aidé de Pierre de Reggio, d’après la version espagnole de Yehûdâ ben Môshê [11]. Aussi cet intermédiaire vernaculaire n’a-t-il pas laissé d’autre trace qu’une rapide mention dans le prologue de la traduction écrite en latin.
Du fait de leur spécificité, de leur reconnaissance bien établie dans la communauté scientifique [12] et des difficultés linguistiques particulières qu’elles présentent, nous avons choisi de ne pas considérer ces traductions latines issues de l’arabe, du grec ou de l’hébreu, qu’elles aient eu ou non un intermédiaire vernaculaire. Nous concentrerons nos efforts sur le défrichage du champ encore relativement neuf des traductions latines issues d’œuvres vernaculaires européennes au Moyen Âge, ce qui inclut naturellement les rétro-traductions latines dans lesquelles l’œuvre latine première a été purement et simplement oubliée au profit de sa traduction en langue vernaculaire, qui acquiert le statut d’un original et est alors retraduite en latin.
Les premières traductions latines d’œuvres vernaculaires
Les problèmes de communication posés par l’apparition et le développement des langues vernaculaires – dérivées du latin, comme les langues romanes – ou par la renaissance des langues anglo-saxonnes et germaniques, furent modifiés quand ces langues entrèrent en concurrence avec le latin comme langues littéraires [13], aussi bien comme véhicules de traduction à partir du latin que comme langues de production [14] d’œuvres originales.
Le corpus retenu est vaste : si les documents de la pratique – chartes [15] et cartulaires – présentent du fait de leur nature même des cas fréquents de traduction de vernaculaire au latin ou de latin vers une langue vernaculaire, voire des cas de double rédaction, ces documents, non littéraires, n’entrent pas dans notre objet d’étude. Nous nous limiterons aux textes littéraires [16] au sens le plus large : des œuvres historiques, lyriques, morales, religieuses, scientifiques, techniques, aux œuvres prononcées dans une langue vernaculaire pour un public non latiniste, comme les sermons et discours.
Le rapide relevé qui suit se veut une simple esquisse de l’apparition du phénomène des « traductions latines d’œuvres vernaculaires » en Europe occidentale. Une mosaïque de dialectes [17] règne à l’intérieur des différentes aires linguistiques vernaculaires : que l’on songe seulement que le Vénitien Marco Polo aurait dicté en français à un Pisan dans une prison génoise ! Cette dispersion contribue à la difficulté de l’identification des traductions latines, difficulté encore accrue par le peu d’intérêt porté à ces textes par les spécialistes de la naissance des langues vernaculaires. Aussi ne faut-il considérer les lignes qui suivent que comme le résultat d’un sondage ne présentant aucune garantie chronologique sûre, ni aucune prétention à une impossible exhaustivité : les langues envisagées ici sont les principales langues romanes (français, langue d’oc, italien, castillan, catalan) et quelques langues germaniques (allemand, néerlandais) et anglo-saxonne (anglais).
Si, dans les terres d’oïl, la pratique de la prédication au peuple en langue française apparaît généralisée au XIIIe siècle, longtemps la mise en forme littéraire du sermon se fit après coup en latin. Selon la formule de Vittorio Coletti [18], « la "latinisation" était le seul moyen qui permettait aux sermons en langue vulgaire de résister à l’usure du temps et de gagner la dignité de l’écrit ».
Un seul sermon écrit en français – le sermon d’Amiens [19] (Paris, BnF, Picardie 158, f. 131v-138v) prononcé vers 1276 dans une paroisse du diocèse d’Amiens – correspond pour le XIIIe siècle à une prédication orale française antérieure. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le début du phénomène « traduction d’œuvre vernaculaire en latin » ait concerné le genre homilétique : on en veut pour preuve les soixante-dix homélies prononcées entre 1168 et 1175 en français par l’évêque de Paris, Maurice de Sully [20], avant d’être traduites en latin.
À la même époque, un événement de grande importance pour l’histoire des pays anglo-saxons, l’assassinat de Thomas Becket dans sa propre cathédrale le 29 décembre 1170, inspira à Guernes de Pont-Sainte-Maxence [21] un poème en français de plus de 6000 alexandrins, la Vie de saint Thomas Becket (rédigée entre 1172 et 1174 en Angleterre), qui fut remanié sous la forme d’un récit en latin dès 1176-1177 par Roger de Pontigny.
En langue d’oc, le phénomène débute non avec le sermon en langue vulgaire attribué à Arnaud Amalric, abbé de Grandselve, puis de Cîteaux en 1201-1202, qui fut traduit en latin avant 1203 par Alain de Lille [22], mais dès la deuxième moitié du XIIe siècle (vraisemblablement vers 1176) avec la traduction latine par Richard de Pise [23] de lo Codi, version provençale établie vers 1165 et inspirée de la Summa Codicis (commentaire systématique du Code de Justinien). Sur cette traduction latine viendront se greffer une rétro-traduction en langue d’oc et une traduction en dialecte dauphinois [24].
Plus tard, vers le milieu du XIIIe siècle – vraisemblablement en 1243 d’après la double dédicace –, Uc Faidit rédigea en Italie pour deux seigneurs italiens de la cour de Frédéric II, Giacomo de Mora et Coraduccio de Sterleto, le Donatz proensals [25], traité de métrique doublé d’une grammaire de la langue d’oc, qui crée ses propres exemples au lieu de citer les troubadours ; ce Donatz proensals est accompagné d’une traduction latine dont l’auteur et la date sont inconnus. Le plus ancien manuscrit [26] du Donatz proensals, Florence, Bibl. Medicea-Laurenziana, Edili 187, copié au XIIIe siècle par une main italienne, conserve cette traduction latine disposée entre les lignes du texte en langue d’oc : elle a donc été ajoutée à un texte d’oc déjà complet. Il n’est pas exclu que l’auteur inconnu de cette traduction latine soit Uc Faidit lui-même.
Les lettres italiennes prirent leur autonomie plus tardivement [27], et la question des traductions latines se complique du fait qu’à partir du milieu du XIVe siècle la culture laïque italienne redécouvre, pour près d’un siècle, l’usage du latin, après une époque d’expansion littéraire de la langue vulgaire. La « question de la langue » née au XVIe siècle – certains [28] la font même remonter au De Vulgari Eloquentia de Dante, donc aux années 1303-1305 – a longtemps passionné les chercheurs [29]. Toutefois, il est admis aujourd’hui que la littérature en prose vernaculaire fleurit en Toscane plus tôt que dans les autres régions, où le latin reste encore la langue littéraire d’élection ; mais nombreux sont, dès le début du XIVe siècle, les lettrés italiens [30] qui composent aussi bien en latin qu’en toscan ou en d’autres dialectes [31], ou qui traduisent leurs œuvres latines en langue vernaculaire, et le phénomène se poursuit au XVe siècle. Cependant, le latin qui « retrouve ses privilèges » [32] vers le milieu du XIVe siècle n’est plus le latin médiéval, mais le latin classique des manuscrits anciens. Aussi n’y aurait-il rien d’étonnant à ce que les premières traductions latines d’œuvres vernaculaires se trouvent en Italie, comme en France, du côté de la littérature religieuse [33], de l’homilétique [34] et de l’hagiographie.
Relevant d’un tout autre genre littéraire, le texte de Marco Polo a été plusieurs fois traduit en latin et c’est dans cette langue qu’il a eu la plus large diffusion. La traduction la plus connue est due au dominicain de Bologne Francesco Pipino, dans les années 1315-1320 ; cette version latine a servi de base à de nombreuses traductions dans d’autres langues vernaculaires [35].
Le XIVe siècle vit une autre traduction latine fameuse : la célèbre adaptation latine, par Pétrarque en 1374 – un an à peine avant la mort de Boccace et dans une lettre qu’il lui adressait –, de la dernière nouvelle du Décaméron (Griselda). C’est de cette traduction latine et non de l’original toscan que devait naître l’immense popularité de l’histoire de Griseldis au Moyen Âge. Devait suivre une traduction latine versifiée de la Commedia de Dante, commencée par Matteo Ronto [36] en hexamètres peu après 1392. Un contemporain de Matteo Ronto, Giovanni da Serravalle (mort en 1445), produisit quant à lui, au début du XVe siècle, une traduction latine en prose de la Commedia.
La péninsule Ibérique offre jusqu’au XVe siècle le spectacle d’un émiettement politique et linguistique sans égal. Les nombreux comtés, principautés et royaumes, qui surgirent lors des campagnes menées par les chrétiens – pour essayer de récupérer les territoires perdus à la suite de l’invasion arabo-berbère – dans le processus qui sera plus tard nommé Reconquista, s’unissaient et se divisaient souvent au gré des mariages et des héritages. Aux XIIe et XIIIe siècles, lors de l’éclosion des littératures en langue vulgaire, la situation politique n’était pas encore simple, même si l’on assistait progressivement à une concentration des pouvoirs.
À cette situation correspondait une fragmentation linguistique importante : ainsi au nord de la péninsule, on trouvait le gallégo-portugais, l’asturien, le castillan, le basque, l’aragonais et le catalan. Une certaine répartition des rôles s’établit avec l’expansion chrétienne progressive vers le sud, pendant qu’une société de cohabitation avec les minorités religieuses juives et musulmanes s’installait dans les royaumes chrétiens. Dans les royaumes de la partie occidentale, en Castille et en León, l’expression littéraire se développa en gallégo-portugais – langue [37] qui « régna » pendant la quasi-totalité des XIIIe et XIVe siècles sur la poésie langoureuse des cancioneiros, transmettant l’influence des poètes français – et en castillan, tandis que dans la partie orientale, dans les royaumes de la couronne catalano-aragonaise, c’est en aragonais mais surtout en catalan que la littérature vernaculaire prit corps, faisant toutefois une large part à l’occitan pour la poésie.
Le castillan étant aux XIIIe et XIVe siècles employé de préférence, dans les royaumes de la partie occidentale, pour les textes épiques, historiques et scientifiques, il n’y a rien d’étonnant à ce que la continuation de la Chronique de Rodrigue de Tolède, la Chronique des rois de Castille (1248-1305) rédigée « in romancio » (en castillan) par Jofré de Loaisa [38], archidiacre de Tolède, fût transposée en latin vers 1305, à la demande de Jofré lui-même, par un chanoine de Cordoue, Armand de Crémone. Il s’agit là vraisemblablement de la première traduction latine d’une œuvre vernaculaire de la Péninsule.
Un peu plus tardive fut la traduction latine entreprise en 1313-1314 par le dominicain catalan Pierre Marsile et offerte par lui à Jacques II, roi d’Aragon (1291-1327) et de Sicile (1285-1295) à la fin de la messe célébrée le jour de la fête de la Trinité de 1314 au couvent des frères prêcheurs de Valence. Sous le titre Liber gestorum Jacobi primi [39], Marsile avait traduit en l’amplifiant le Llibre dels feits del rei en Jacme, qui relatait les exploits de Jacques Ier le Conquérant, roi d’Aragon de 1213 à 1276. Son but aurait été d’attirer l’attention du pape Clément V, l’Aquitain Bertrand de Got, sur la « croisade » que Jacques II voulait promouvoir dans la péninsule Ibérique contre les musulmans. La traduction latine s’inscrivait également dans la continuité de l’historiographie latine autour de la maison royale catalane : le Liber gestorum Jacobi primi pouvait être perçu comme une suite des Gesta comitum Barcinonensium et regum Aragonum, composés au XIIIe siècle au monastère de Ripoll et exposés à plusieurs reprises, la dernière fois entre 1303 et 1314, à l’époque même de la traduction de Marsile.
L’antériorité du Llibre dels feits del rei en Jacme sur le Liber gestorum Jacobi primi [40] a fait longtemps l’objet de controverse, mais elle est maintenant bien établie [41]. En outre, des passages d’une traduction catalane du texte latin de Pierre Marsile [42] servirent de base au XIVe siècle au Sermó de la conquesta, habituellement prêché le 31 décembre pour la fête de l’Étendard.
Dans le monde germanique, la première traduction latine pourrait être celle que donna Ekkehard IV (v. 998-v. 1060) du Lobgesang auf den heiligen Gallus, composé par le moine bénédictin Ratpert [43] vers la fin du IXe siècle et aujourd’hui perdu. Plus récente, puisque datée vers 1212-1218, mais plus « connue » est la traduction de l’épopée historique en vers allemands Herzog Ernst [44] par Odon de Magdebourg [45] en 3600 hexamètres sous le titre Gesta Ernesti ducis. Ce poème latin devait faire l’objet au milieu et à la fin du XIIIe siècle de deux mises en prose latine [46], œuvres d’adaptateurs inconnus.
Pour les lettres néerlandaises, c’est vraisemblablement le Van den Vos Reinaerde qui fut le premier texte à être traduit en latin (en 1850 vers) par Baudouin le Jeune au XIIIe siècle sous le titre Reynardus Vulpes [47].
Dans les pays anglo-saxons, si les efforts du premier abbé d’Eynsham, Aelfric (vers 955-1014), réussirent à hausser l’anglais au niveau d’une langue de prestige à l’égal du latin, la bataille d’Hastings (1066) entraîna, avec l’arrivée des Plantagenêts et de leur entourage français, une régionalisation de l’anglais et son émiettement en dialectes, pendant que le français devenait la langue officielle du souverain. Pour de nombreuses années, l’Angleterre était devenue trilingue. La ré-émergence officielle de l’anglais [48] fut l’une des conséquences de l’essor économique et politique de la bourgeoisie londonienne, originaire des Midlands, au XIVe siècle. Dès lors, le français – un franco-normand – coupé du continent par les désordres politiques devait s’étioler et les conditions être réunies pour que des œuvres composées en anglais fussent traduites en latin.
Toutefois, la première œuvre de la littérature anglaise à témoigner d’une traduction en latin [49] pourrait être très ancienne : ce serait le premier poème en ancien anglais, l’Hymne composé par Caedmon au VIIe siècle. Le poème n’a pas subsisté sous sa forme originale, mais dans une adaptation latine faite par Bède le Vénérable et insérée dans son Historia Ecclesiastica [50], achevée en 731. Dans le cas, nettement plus récent de l’Ancrene Wisse [51] (ou Ancrene Riwle) composée après 1236 – et non entre 1215 et 1222 comme on l’a cru longtemps [52] –, pour trois nobles recluses qui résidaient à Derfold, non loin de l’abbaye de Wigmore – à la frontière occidentale des Midlands –, l’original vernaculaire a été conservé. C’est l’œuvre d’un inconnu, vraisemblablement un dominicain de l’abbaye de Chester, fondée en 1236 ; l’attribution du texte à Brian de Lingen, de l’abbaye de Wigmore, a été écartée [53]. L’évêque de Salisbury Simon de Gand (mort en 1315) en donna une version latine [54] moins d’un siècle plus tard : cette traduction entre en concurrence avec deux versions françaises [55] établies elles aussi sur des textes anglais.
Dans le domaine historique, l’Historia regis Waldei du moine anglais de Thetford, John Bramis [56], adaptation en prose latine d’une version – aujourd’hui perdue – en moyen anglais d’un poème anglo-normand anonyme datant du début du XIIIe siècle, l’Estoire de Waldef [57] , est nettement plus récente, car elle ne remonte qu’au début du XVe siècle.
Pour les pays scandinaves, la première traduction latine paraît avoir été celle de Saxo Grammaticus (v. 1150-v. 1220) qui aurait inséré des traductions latines de récits et de poèmes en ancien anglais et en ancien norrois au fil de sa narration des Gesta Danorum [58], commencées vers 1185 et terminées vers 1206.
Les limites de ce survol européen sont nettes : d’une part, la chronologie de ces premières traductions latines d’œuvres vernaculaires, très variable suivant la langue et même le dialecte d’origine, reste toute relative et susceptible d’être remise en cause par la découverte de nouveaux témoins ; d’autre part, certaines langues vernaculaires n’ont pu être envisagées, faute de compétences : le franco-provençal, le basque, les langues celtiques, l’italo-grec… Par la formation et la spécialisation des membres fondateurs, le projet s’est naturellement tourné en priorité vers les traductions latines de textes écrits dans l’une ou l’autre des principales langues romanes. Toutefois, l’inclusion des autres grandes familles de langues d’Europe de l’Ouest (germaniques, celtiques et basque) n’est absolument pas exclue. (…) Le traitement des traductions latines d’une langue vernaculaire donnée ne dépend que de la collaboration d’un spécialiste compétent.
Une recherche encore embryonnaire
Deux articles de synthèse avaient marqué le début de l’étude des traductions latines d’œuvres vernaculaires : W. Leonard Grant (European Vernacular Works in Latin Translation, dans Studies in the Renaissance, t. 1 [1954], p. 120-156) avait relevé les traductions latines publiées dans des ouvrages imprimés de la Renaissance jusqu’au XIXe siècle ; André Vernet (Les traductions latines d’œuvres en langues vernaculaires au Moyen Âge, dans Traductions et traducteurs, Colloque international du CNRS, Paris, 26-28 mai 1986, Paris, 1989, p. 225-241) s’était intéressé aux œuvres médiévales, surtout celles qui avaient pour origine un texte français. Les relevés de W. Leonard Grant et d’A. Vernet se recoupant partiellement, nous pouvons compter sur au moins soixante-dix cas dûment établis pour le Moyen Âge, tous genres littéraires confondus. Ce nombre interdit de considérer comme négligeable le phénomène « traduction d’œuvre vernaculaire en latin » et laisse espérer de nouvelles découvertes [59], notamment parmi les œuvres composées dans les trois derniers siècles du Moyen Âge et au début de la Renaissance.
Les travaux tout récents laissent bien augurer des découvertes futures, surtout si l’on ajoute les cas « limites » que sont les rédactions doubles ou les « rétroversions » en latin. En ce qui concerne le cas particulier des rétro-traductions latines, certaines sont fort célèbres, comme les Enseignements à son fils Philippe, de saint Louis [60], ou le De vita curiali, d’Alain Chartier [61] , dont la version française anonyme fera l’objet d’une rétro-traduction latine par Robert Gaguin. L’étude des traductions latines d’œuvres vernaculaires ne doit pas les négliger, ni faire oublier le phénomène beaucoup plus rare des doubles rédactions, celui où un auteur écrit lui-même la version latine de son œuvre ou bien accepte la traduction latine faite par ses disciples : c’est notamment le cas du philosophe majorquin Raymond Lulle, dont l’immense production livresque multilingue ne saurait s’expliquer que par l’assistance de certains de ses disciples et auditeurs. Raymond Lulle [62], bien que se disant vers 1288 « non multum apud latinos sermones consuetus » [63], savait assez de latin pour composer directement dans cette langue des œuvres aussi différentes les unes des autres que son Arbor scientiae [64] à Rome en 1295-1296, la Logica nova [65] à Gênes en mai 1303, la Disputatio fidei et intellectus à Montpellier en octobre 1303 ou le Liber de venatione substanciae, accidentis et compositi [66], écrit dans la même ville en février 1308. Toutefois, en 1311 – donc cinq ans avant sa mort – il préféra dicter à un tiers, un moine anonyme de la chartreuse de Vauvert à Paris, son autobiographie, cette Vita coaetanea [67] qui semble avoir été élaborée comme une œuvre de propagande destinée au concile de Vienne.
En outre, « si nous accordons volontiers à un écrivain le droit de modifier à sa guise son propos quand il présente un ouvrage en double rédaction, certains traducteurs médiévaux se sont arrogé (…) cette liberté en remaniant le fond et la forme des œuvres tombées entre leurs mains » [68]. De ce fait, il devient difficile de distinguer la traduction latine « pure » de l’adaptation qui constitue une sorte de « traduction-adaptation ». Ainsi, dans le premier quart du XVe siècle, Nicolas de Clamanges transposa en 64 hexamètres classiques, sous le titre : « Descriptio vite rustice cum laude et commendatione » [69], le poème intitulé « Dit de Franc Gontier » [70] composé par l’évêque de Meaux Philippe de Vitry en 4 huitains de décasyllabes ; l’adaptateur, émule de Virgile, doubla ainsi la longueur de l’œuvre qui passa de 32 vers en français à 64 en latin. Puis le même Nicolas de Clamanges adapta de la même manière le poème composé par l’évêque de Cambrai Pierre d’Ailly, entre 1398 et 1402, en réplique au « Dit de Franc Gontier » de Philippe de Vitry : les « Contredits de Franc Gontier » en 4 huitains de décasyllabes donnèrent ainsi naissance à un poème latin en 83 hexamètres, la « Descriptio vite tirannice cum detestatione et reprobatione » [71]. Comme les deux poèmes français, les deux adaptations latines [72] sont conservées dans les mêmes manuscrits [73] pour finir par se retrouver avec leurs modèles français dans le même incunable [74], formant un dialogue littéraire à trois voix et en deux langues.
Il faut noter que dans les grands débuts de l’expansion de ce phénomène de traduction latine – aux XIIe et XIIIe siècles – le latin restait, pour l’Europe occidentale au sens moderne, la langue unique de la philosophie, de la théologie et de la liturgie, la langue par excellence de la diffusion scientifique, alors que le XIVe siècle vit s’amplifier un grand mouvement de traductions dans les langues vernaculaires (en particulier le français [75] mais aussi l’italien, le castillan, le catalan) d’ouvrages philosophiques, moraux, encyclopédiques composés en latin.
Déjà Alphonse X le Sage (1252-1284) avait imposé, comme langue de traduction [76], aux traducteurs tolédans qui travaillaient pour lui le « roman castillan » en lieu et place du latin, donnant par là à la langue espagnole le statut de langue de diffusion scientifique et philosophique. Un peu plus tard, les traducteurs royaux de l’entourage de Charles V (1364-1380) devaient contester de fait au latin l’exclusivité de l’expression savante : consacrant « une part importante de leur activité à exporter en domaine français la culture savante latine » [77], ces traducteurs furent amenés à repenser le rapport entre les deux langues.
Mais la place occupée par le latin médiéval – langue de science : nous n’en voulons pour preuve que le succès du colloque sur « Le Latin, langue du savoir, langue des savoirs » organisé à l’École Normale Supérieure [78] du 11 au 14 octobre 2000 – faisait de « la plupart des lettrés médiévaux des bilingues originaux en symbiose avec une langue de prestige dont ils étaient imprégnés dès leur scolarité élémentaire » [79].
Les questions posées par l’étude des traductions latines d’œuvres vernaculaires sont donc nombreuses. Quel rôle joue le latin médiéval – si éloigné du latin classique – quand il sert de langue de traduction à une œuvre vernaculaire ? Comment apprécier le registre latin adopté dans ces traductions ? Y a-t-il une sorte de « hausse du niveau hiérarchique » du texte ? Qui « traduit en latin » – des professionnels religieux ou laïcs, des amateurs plus ou moins éclairés – et dans quel milieu évoluent ces traducteurs d’œuvres vernaculaires en latin ? Comment ces traducteurs et leurs commanditaires/lecteurs ressentent-ils la relation entre leur langue « maternelle » et le latin ? Quelle est l’importance du vocabulaire vernaculaire passé dans les traductions latines et des graphies de type dialectal introduites dans le texte latin ? Quel est l’enjeu de la traduction en latin pour la diffusion d’une œuvre née vernaculaire ?
Aspects méthodologiques
L’identification des traductions latines d’œuvres vernaculaires peut être délicate du fait de l’absence très fréquente de prologue, donc de nom de traducteur et d’indication de traduction, mais aussi de l’absence de titre, d’explicit ou de colophon : dès lors appréhender le fait qu’un texte latin puisse être la traduction d’un original vernaculaire devient difficile. Seules peuvent aider les caractéristiques de la langue latine utilisée (mots calqués, voire repris sans être traduits ; syntaxe de type vernaculaire ; anglicismes, gallicismes, italianismes …) et la connaissance de la possible œuvre-source. Très précieux sont aussi les recours au style direct dans les récits ou encore les phrases conservées dans les procès-verbaux, qui peuvent montrer que le dialogue se déroulait en langue vernaculaire.
Dans notre perception actuelle du phénomène des traductions latines d’œuvres vernaculaires, nous pouvons être handicapés par le fait que nous avons appris le latin comme une langue étrangère à caractère savant et que nous peinons à nous orienter dans les différents registres du latin médiéval. Notre vision ne doit pas être déformée par le « jugement de valeur » que nous aurions tendance à porter sur la « qualité » du latin pratiqué par tel ou tel traducteur : même si une simple recette médicale traduite en latin « à la va vite » fait pâle figure à côté du magnifique exercice que constitue la traduction du Curial (en réalité une rétro-traduction du De vita curiali) par Robert Gaguin, les deux textes sont bien, tous deux, des traductions latines d’œuvres vernaculaires. S’il est peut-être plus aisé, par exemple, à un italianisant de repérer les italianismes d’un texte latin et si ce sont, le plus souvent, des spécialistes de textes vernaculaires qui s’intéressent à ce type de traduction, la recherche est grande ouverte aux latinistes.
Le modèle de description établi et validé durant la journée d’études du 26 avril 2001 sur « Les traductions latines d’œuvres en langues vernaculaires au Moyen Âge : recensement et méthodologie » [80] permet une appréhension fine au moyen des titres et des colophons – dans les cas où ils existent –, des incipit et explicit développés, des possibles indications de lieu ou de date. En outre, des précisions sur les contextes de copie ou d’édition des traductions peuvent donner des indices sur leur mode de diffusion et leur mise en circulation.
Il eut été malaisé et très lourd d’établir sur papier un répertoire comportant toutes les entrées requises par un corpus de traductions : auteur originel, titre d’origine, traducteur, titre de la traduction, témoins conservés … Un tel répertoire aurait nécessité des renvois pénibles et risquait d’entraîner des redoublements dans la présentation des œuvres et des témoins.
Le recours à un logiciel de base données, en ligne, est apparu hautement souhaitable. D’où le choix de saisir les données rassemblées par le groupe Tradlat dans la base BUDE (Base Unique de DocumentationEncyclopédique) en gardant la mention de l’origine « tradlat ».
Conclusion
Le phénomène des traductions latines directement établies sur des œuvres originales composées dans des langues vernaculaires nous amène naturellement à réfléchir et à revoir certaines notions, parfois évidentes, sur la traduction au Moyen Âge et au début de la Renaissance. Il s’agit d’abord et avant tout de la fidélité à l’original (pour autant qu’on puisse l’identifier précisément) : quels sont les degrés de fidélité qui se dégagent de ces diverses traductions et à quoi chacun correspond-il ? Dans chaque traduction, d’une gamme qui va de la traduction au plus près de la lettre du texte source au remaniement qui interpole une grande part de matière nouvelle, peut-on voir le reflet des attentes d’un mécène ou de la conception que s’était formé un traducteur à l’égard de son activité « en un temps où la propriété littéraire et le respect scrupuleux de la lettre n’étaient pas le premier souci des interprètes » [81] ? L’étude de ce problème se complique passablement lorsque l’on découvre de possibles traductions dans d’autres langues vernaculaires, dont il faut déterminer si elles remontent à l’original vernaculaire ou à une traduction latine qui aurait servi de « relais ».
À cette question de la fidélité, vient s’ajouter une série d’autres qui constituent en fait le questionnement sous-jacent à tout le projet et auquel, par la fréquentation et le relevé de tous les cas possibles, nous cherchons à apporter des réponses : Que traduisait-on en latin dans les derniers siècles du Moyen Âge, puis à la Renaissance ? Pour qui ? Par qui ? Comment ? Et la question la plus brûlante : Pourquoi ? Pour atteindre un plus large public ? En effet, sans être à coup sûr un gage de succès, la traduction latine représentait-elle pour une œuvre vernaculaire la condition d’une diffusion à l’échelle de l’Europe occidentale, donc l’accession à un statut « international » ?
Il est en tout cas certain que les traductions latines d’œuvres vernaculaires contribuèrent à maintenir très longtemps le statut d’universalité du latin à l’intérieur de l’Europe, ce latin médiéval qui était devenu une langue commune aux milieux cultivés de toutes les nations entre lesquelles s’étaient fragmentées la langue et les provinces de l’Empire romain. Cependant, même en tant qu’outil privilégié de communication [82], le latin médiéval ne saurait être considéré systématiquement comme l’équivalent médiéval d’un « basic English », car les traductions latines d’œuvres vernaculaires présentent fréquemment des amplifications ou des innovations littéraires, tout au rebours d’une réduction au message minimal.
D’où une interrogation hétérodoxe : Et si le latin médiéval, cette langue que les hommes des XIIe-XVe siècles apprenaient comme une langue seconde, n’avait été, au moins dans certains de ses usages, qu’une langue de « vulgarisation » comme une autre ?
par : Laurent Brun, Frédéric Duval, Françoise Fery-Hue et Christine Gadrat
(avec l’aimable autorisation de la rédaction de la revue « Scriptorium »)
On trouvera ci-dessous une version imprimable au format PDF .

Docta interpretatio in latinum sermonem "Traductions savantes vers le latin" : colloque organisé à l’ ENSSIB les 22 et 23 novembre 2013
Vient de paraître :
Traduire de vernaculaire en latin au Moyen Age et à la Renaissance. Méthodes et finalités. Études réunies par Françoise Fery-Hue, Paris, École des Chartes, 2013, 342 pages (Études et rencontres de l’École des chartes, 42). ISBN 978-2-35723-035-4 - Prix France : 32€
Consacré à la traduction au sens le plus large, le récent colloque du Medieval Translator à Louvain du 8 au 12 juillet 2013 :
The Medieval Translator 2013 / The Cardiff Conference on the Theory and Practice of Translation in the Middle Ages
"Translation and Authority - Authorities in Translation"
fournit de nouvelles contributions sur les traductions de vernaculaire en latin et sur l’apprentissage des langues vernaculaires à l’aide du latin
Nikolaus Thurn, Neulatein und Volkssprachen. Beispiele für die Rezeption neusprachlicher Literatur durch die lateinische Dichtung Europas im 15.-16. Jh., München, Wilhelm Fink, 510 p. (Humanistische Bibliothek, Texte und Abhandlungen, 61).