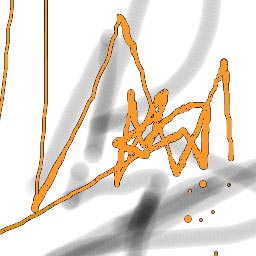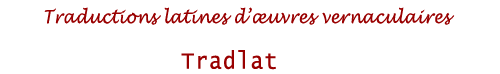Corpus des auteurs connus : noms commençant par R ou S.
Un losange rouge ♦ signale les œuvres vernaculaires médiévales traduites au Moyen Âge ou à la Renaissance.
- ♦ Ratpert (vers la fin du IXe siècle), Lobgesang auf den heiligen Gallus aujourd’hui perdu, traduit en latin par Ekkehard IV (v. 998-v. 1060) (Voir Ratperts Lobgesang auf dem heiligen Gallus, dans Karl MÜLLENHOFF et Wilhelm SCHERER (éd.), Denkmäler deutsche Poesie und Prosa aus den 8.-12. Jahrhundert, 1e éd. Berlin, 1864, 3e éd. revue par Elias von STEINMEYER, Berlin, 1892, p. 78-85, n° XII. Les éditions du poème latin sont nombreuses, en particulier celles qui reproduisent la rédaction A : voir Jacob GRIMM et Andreas SCHMELLER, Ratperti Carmen de St. Gallo, dans id. (éd.), Lateinische Gedichte des X. und XI. Jahrhundert, Göttingen, 1938, p. XXV et XXX-XXXVI, et Édélestand DU MÉRIL, Poésies populaires latines antérieures au douzième siècle, Paris, 1843, p. 156-161. Une édition synoptique des trois manuscrits latins conservés a été établie par : Peter OSTERWALDER, Das Althochdeutsche Galluslied Ratperts und seine lateinischen Übersetzungen durch Ekkehart IV : Einordnung und kritische Edition, Berlin - New York, 1982 (Das Althochdeutsche von St. Gallen, 6) (A. Vernet, p. 238).
- ♦ Raymond Lulle (vers 1232-1315). Plusieurs de ses oeuvres catalanes existent également en latin, mais il est difficile de démêler les oeuvres originalement écrites en latin qu’il a lui-même traduites en catalan de celles écrites en catalan et traduites en latin. Il existe également des cas où certaines de ses oeuvres ont été traduites en latin par d’autres. Voir la [Base de dades Ramon Llull->http://orbita.bib.ub.es/llull/], qui fournit la liste des toutes les versions avec leurs manuscrits et éditions : dans les notices décrivant les “œuvres”, au début de la description des œuvres, il y a un « chapeau » avec des données essentielles sur l’œuvre parmi lesquelles l’indication de la « version originale » ; lorsque la précédence d’une version sur l’autre à pu être établie, à la suite du titre de la version on précise s’il s’agit de la version originale ou de la traduction, et à partir de quelle langue celle-ci a été établie (p.e., sous Liber principiorum medicinae : començaments de medicina, on trouve « Versió catalana : Començaments de medicina [versió original] » et, à la suite « Versió llatina : Liber principiorum medicinae [traducció del català] »).. * Llibre de contemplació devenu Liber contemplationis (dont un volume de l’exemplaire donné à la chartreuse de Vauvert en 1298 par Lulle lui-même est aujourd’hui le ms. Paris, BnF, lat. 3348 A) [mais il n’indiquait pas que Raymond Lulle avait rédigé primitivement son Llibre de contemplació en arabe, puis l’avait lui-même traduit en catalan] (A. Vernet, p. 235). * Le Livre du gentil et des trois sages ; deux versions latines du 14e siècle encore inédites (cf. éd. A. Llinarès, Paris, 1966, p. 21 et n. 76) (A. Vernet, p. 235). * Le Libre de sancta Maria, composé en catalan en 1290, fait l’objet de plusieurs traductions latines : une première, établie autour de l’université de Paris, est conservée dans le manuscrit Paris, BnF, lat. 3174 (f. 1-132), dans le Liber de laudibus B Virginis Mariae, ed. Jacques Lefèvre d’Étaples (Paris, Guiot le Marchand et Jean Petit, 1499), et dans le manuscrit Augsbourg, Staats- und Stadtbibliothek, 2° Cod. 194 (f. 1-115) ; une autre, produite vraisemblablement à Majorque ou à Valence (Espagne), figure dans les manuscrits Munich, Bayerische Staatsbibliothek, clm 10519 (f. 22-59), Séville, Biblioteca Colombina, 7-6-41 (f. 169-211) et Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 684 (f. 1-60). Voir Blanca Garí, Les traductions en latin du Libre de Sancta Maria de Raymond Lulle, dans Pour une histoire comparée des traductions. Traductions des classiques, traductions du latin, traductions des langues romanes du moyen-âge et de la première modernité, éd. D. de Courcelles et V. Martines Peres, Paris, 2012, p. 91-101 (Études et Rencontres de l’École des Chartes, 36).
- Rémy Belleau, le Papillon, version latine par Étienne Tabourot Des Accords (vers 1575) (renseignement donné par Jean-Marie Flamand ; et DLF, XVIe siècle, Paris, 2001, p. 1105).
- Rembert Dodoens (1517-1585) est l’auteur du Cruydt-Boeck (1554) ; l’ouvrage est traduit en latin, par l’auteur, sous le titre Stirpium historiae pemptades sex (1583) ; il fait l’objet d’une édition augmentée Cruydt-Boeck : met biivoegsels achter elck Capittel, vvt verscheyden Cruydtbeschrijvers : item in’t laetste een Beschrijvinge vande Indiaensche Gewassen meest getrocken wt de Schriften van Carolus Clusius / van Rembertus Dodonaeus (Leyde, Plantin pour Francois van Ravelingen, 1608). [signalé par FFH].
- Rinaldo Odoni, Discorso per via peripatetica (Venise, 1557), traduit en latin par Jacques Charpentier (1524-1574) sous le titre Disputatio de animo, methodo peripatetica, utrum Aristoteli mortalis sit, an immortalis, ex R. Odonis, Itali, vernaculis latina facta per Jacobum Carpentarium... Adjectis ejusdem Carpentarii scholiis (Paris, M. David, 1558) [signalé par FFH]
- ♦ Robert Gaguin traduit de français en latin l’épitaphe du duc de Bourgogne Philippe III le Bon en retour de quoi il est payé 16 livres ( !) (cf. Comte de Laborde, Les ducs de Bourgogne, études sur les lettres, les arts et l’industrie pendant le XVe siècle, Paris, 1849, t. II/1, p. 499, n° 1935). [signalé par LB].
- ♦ Robert Grosseteste (c. 1175-1253) rédige pour la comtesse de Lincoln, entre 1240 et 1242, des Reules intitulées " Isci comencent les reules ke le bon eveske de Nichole Robert Grosseteste fist a la contesse de Nichole de garder et governer terres e hostel ", qui sont traduites en latin avant sa mort en 1253 sous le titre " Hic incipiunt regule quas bone memorie Robertus Grosseteste fecit comitisse Lincoln ad custodiendum et regendum terras ospicium et domum et familiam " (ms. Oxford, Bodleian Library, Digby 204, f. 3r-5r, copié dans la seconde moitié du XIIIe siècle) ; cette traduction latine est ensuite traduite en anglais (ms. Londres, British Library, Sloane 1986, f. 100r-102r, qui date du XVe siècle). Voir Dorothea Oschinsky, Walter of Henley and Other Treatises on Estate Management and Accounting, Oxford, Clarendon Press, 1971, p. 191-197, 388-407 (édition du texte français), 412-415 (extraits de la traduction latine). [signalé par Joëlle Ducos].
- Rösslin, Euchaire (Eucharius Rhodion ; 1470-1526), d’abord apothicaire à Fribourg-en-Brisgau, puis médecin à Francfort, puis à Worms au service de la duchesse Catherine de Brunswick-Lunebourg, écrit un traité d’obstétrique : Der Swangern Frawen und Hebammen Roszgarten (Strasbourg, 1513). Son fils, également prénommé Euchaire, le traduit en latin : De partu hominis et quae circa ipsum accidunt (Francfort, Christof Egenolph, 1532 ; Paris, Jean Foucher, 1535 ; Paris, Jean Foucher, 1538 ; Francfort, Christof Egenolph, 1551, puis 1554 ; Francfort, héritiers de Christof Egenolph, 1563). Suivent une première traduction française anonyme [par Antoine Bonnemère ?] : Des divers travaux et enfantemens des femmes (Paris, Jean Foucher, 1536, puis 1540), une traduction anglaise, due à Richard Jones, The Birth of Mankind (Londres, 1540 ; avec des rééditions et des mises à jour jusqu’en 1654) et une seconde traduction française, retravaillée par un nouveau traducteur, qui est publiée en 1563 ou 1577 (et connaît de nombreuses rééditions : 1584, 1586, 1602, 1632). Voir Sir D’Arcy Power, The birth of mankind or the woman’s book. A bibliographical study, dans The Library, t. 8 (1927), n° 1, p. 1-37 [renseignement donné par J.-M. Flamand].
- Rudolf Gwalther (1519-1586). Le théologien et poète zurichois Gwalther, déjà traducteur en latin des oeuvres de Zwingli, compose son traité Der Endtchrist (Zurich, Christoph Froschauer, 1546) en allemand et le traduit lui-même en latin : la comparaison entre la préface allemande, datée 8 décembre 1546, et la préface latine du 12 décembre 1546 fait connaître les différents publics ciblés par les deux versions. Voir Urs B. Leu, "Les traductions latines des imprimés vernaculaires zurichois du XVIe siècle", dans Françoise Fery-Hue et Fabio Zinelli, eds., Habiller en latin. La traduction de vernaculaire en latin entre Moyen Âge et Renaissance, Paris, 2018, p. 347-358 (Études et rencontres de l’École des Chartes, 52).
- ♦ Saxo Grammaticus (v. 1150 - v. 1220) aurait inséré des traductions latines de récits et de poèmes en ancien anglais et en ancien norrois dans ses Gesta Danorum (Scriptorium, p. 97).
- ♦ Sebastian Brant (1457-1521), Narrenschiff (1494), traduction latine par Jacob Locher (Stultifera Navis) en 1497 (voir Marc Moser, Traduction-trahison-adaptation et/ou métamorphose à l’exemple de la "Nef des fous" de Sébastien Brant et de sa version latine créative "Stultifera navis" de Jakob Locher, dans Pratiques de traduction au Moyen Âge / Medieval Translation Practices, Actes du colloque de l’université de Copenhague, 25 et 26 octobre 2002, éd. P. Andersen, Copenhague, 2004, p. 96-99) ; cette traduction latine est ensuite adaptée en vers français par Pierre Rivière (mort en 1499) ; puis le poème de Pierre Rivière (La Nef des Folz du Monde) fut mis en prose française par Jean Drouin (La Grant Nef des Folz du Monde) dès 1498 et servit de modèle, avec les versions latine et néerlandaise, à Alexander Barclay pour son adaptation anglaise en 1507 (voir B. Quillet, Le Narrenschiff de Sebastian Brant, ses traducteurs et ses traductions aux XVe et XVIe siècles, dans Culture et marginalités au XVIe siècle, Paris, 1973, p. 111-124 ; voir la liste des éditions ou recompositions latines dans : Jean-Claude Margolin, Brant (Sébastien), dans Centuriae Latinae, II Cent une figures humanistes de la Renaissance aux Lumières, A la mémoire de Marie-Madeleine de La Garanderie, Genève, 2006, p. 140 [131-145], Travaux d’Humanisme et Renaissance, CDXIV). Les caractéristiques de la première traduction latine Stultifera Navis (Bâle, 1497) sont étudiées par : Bernd Renner, « Juvénal et les Nefs des folz : rhétorique et translatio studii », dans Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, t. 72/2, 2010, p. 283-300. [signalé par JPR]. Plus récemment : Nikolaus Henkel, "Sebastian Brant, Das Narrenschiff (1494) and its Latin version by Jakob Locher, The Stultifera navis (1497)", dans Françoise Fery-Hue et Fabio Zinelli, eds., Habiller en latin. La traduction de vernaculaire en latin entre Moyen Âge et Renaissance, Paris, 2018, p. 93-110 (Études et rencontres de l’École des Chartes, 52).
- Sebastian Virdung (vers 1465-vers 1530), Musica getutscht und außgezogen durch Sebastianus Virdung, Priester von Amberg verdruckt, um alles Gesang aus den Noten in die Tabulaturen dieser benannten dreye Instrumente der orgeln, der Lauten und der Flöten transferieren zu lernen kürzlich gemacht, traité consacré aux instruments de musique , écrit en dialecte bavarois et illustré par Urs Graf (Bâle, 1511). La majeure partie de ce traité, traduite en latin, passe dans la Musurgia seu Praxis musicae, achevée en 1518 par Ottmar Nachtgall (1480-1537), dit Luscinius, qui est imprimée à Strasbourg, chez Johann Schott, en 1536 [signalé par Jean-Marie Flamand].
- Sébastien Vaillant (1669-1722). Le botaniste Sébastien Vaillant publie en 1718 son Discours sur la structure des fleurs (Leyde, Peter Van der Aa, 1718) qui est aussitôt traduit en latin : Sermo de structura florum, horum differentia, usuque, partium eos constituentium... (Leyde, Peter Van der Aa, 1718) et publié par le même éditeur. Voir Marie-Élisabeth Boutroue, "Les livres de plantes du vernaculaire au latin au XVIe siècle", dans Françoise Fery-Hue et Fabio Zinelli, eds., Habiller en latin. La traduction de vernaculaire en latin entre Moyen Âge et Renaissance, Paris, 2018, p. 235-254 (Études et rencontres de l’École des Chartes, 52).
- Stefano Guazzo (1530-1593), La civil conversatione divisa in quattro libri (Brescia, Bazzola, 1574) est traduite en français d’un côté par François de Belleforest : La Civile conversation du s. Estienne Guazzo, Gentilhomme de Montserrat, Traduict d’italien en françoys par F. de Belleforest (Paris, P. Cavellat, 1579, in-8° ; puis Paris, P. Cavellat, 1582, in-12), de l’autre par Gabriel Chappuys : La Civile conversation (Lyon, Jean Béraud, 1579 ; puis Lyon, Jean Béraud, 1580). Quelques années plus tard, Heinrich Coggeman en donne une traduction latine sous le titre De mutua et civili conversatione libri quatuor, italice conscripti, et nunc primo ex postrema authoris recognitione latine redditi per Henricum Coggeman (Cologne, Johannes Gymnicus, 1585, in-8°). [signalé par FFH].
Docta interpretatio in latinum sermonem "Traductions savantes vers le latin" : colloque organisé à l’ ENSSIB les 22 et 23 novembre 2013
Vient de paraître :
Traduire de vernaculaire en latin au Moyen Age et à la Renaissance. Méthodes et finalités. Études réunies par Françoise Fery-Hue, Paris, École des Chartes, 2013, 342 pages (Études et rencontres de l’École des chartes, 42). ISBN 978-2-35723-035-4 - Prix France : 32€
Consacré à la traduction au sens le plus large, le récent colloque du Medieval Translator à Louvain du 8 au 12 juillet 2013 :
The Medieval Translator 2013 / The Cardiff Conference on the Theory and Practice of Translation in the Middle Ages
"Translation and Authority - Authorities in Translation"
fournit de nouvelles contributions sur les traductions de vernaculaire en latin et sur l’apprentissage des langues vernaculaires à l’aide du latin
Nikolaus Thurn, Neulatein und Volkssprachen. Beispiele für die Rezeption neusprachlicher Literatur durch die lateinische Dichtung Europas im 15.-16. Jh., München, Wilhelm Fink, 510 p. (Humanistische Bibliothek, Texte und Abhandlungen, 61).